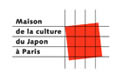100 ans de cinéma japonais (2ème partie)
Du 23 janvier au 18 mars 2019
Perles rares du Japon
L'événement Japonismes 2018, non content de marquer d'une pierre blanche plus de 100 ans de cinéma japonais, à sa manière mettra aussi à l'honneur un siècle de cinéphilie française ; depuis les années 1910, quand Louis Delluc ne cachait pas son émotion devant la modernité du jeu de Sessue Hayakawa dans le Forfaiture de Cecil B. DeMille, la production du Soleil levant est devenue le fantasme intarissable d'un certain public qui, déjà au XIXe siècle, s'extasiait devant le nouveau vocabulaire plastique que proposaient les estampes orientales.
Petite histoire d'une perception française
Il a fallu attendre les années 1920 pour que cette production commence à s'exporter épisodiquement. Si l'on excepte quelques pantomimes filmées anonymement, c'est pour la première fois en mars 1926 qu'est présenté au public un film japonais dans le mythique Studio des Ursulines, vieux théâtre de quartier reconverti depuis peu en salle d'art et d'essai. Musume (Ai no Himitsu) de Frank Tokunaga fut donc projeté entre un court métrage de René Clair et un autre de Louis Feuillade lors d'une de ces matinées réservées aux membres. Cette première expérience fut perçue comme un événement majeur et certains critiques s'attardèrent longuement sur la représentation d'un personnage masculin constamment absent du cadre malgré son importance. En louant la puissance du hors champ dans ce nouveau monde cinématographique qui s'ouvre à eux, l'assistance n'avait pas reconnu la griffe facétieuse du comédien Armand Tallier, propriétaire des lieux, qui, n'appréciant tout simplement pas la prestation de cet acteur, substitua chacune de ses apparitions par des intertitres.
Ces deux événements, impliquant d'importantes figures de l'avant-garde parisienne, signent les prémices d'un intérêt sans cesse renouvelé envers cette cinématographie. Une affection qui s'est concrétisée dans les années 1960 à la Cinémathèque française (lors des programmes coordonnés par mesdames Kawakita et Govaers), puis dans les années 1990 au Centre Pompidou (lors d'une précédente année du Japon) et s'est prolongée au cours de la deuxième partie de cette grande manifestation. « Une histoire Insolite du cinéma Japonais » présentera ainsi une trentaine de titres inattendus, voire totalement inconnus, du public français actuel et passé.
Morceaux choisis
Entièrement autoproduit, Les Enfants de la ruche est une œuvre magnifiquement désarmante, tournée avec de véritables orphelins de guerre prenant la route en compagnie d'un ancien soldat dans un pays dévasté. Cette route, comme toujours chez Hiroshi Shimizu (1903-1966), donne lieu à toutes les possibilités de rencontres et donne au film sa forme, celle d'un mouvement intuitif se soustrayant à toute tentation de construction linéaire. Se voulant plus démonstratif, Kiku et Osamu de Tadashi Imai tient également compte d'une réalité d'après-guerre, jusque-là peu traitée, avec les discriminations dont sont victimes les métisses issus de pères afro-américains. Appartenant à la génération suivante, Tai Kato (1916-1985) incarne également ce basculement du studio system à l'autonomie à travers deux films importants correspondant chacun à des modes de production et d'expression bien distincts. Pour commencer, l'incontournable Ma mère dans les paupières, bijou du matatabi-mono (sous-genre entrechoquant yakuza eiga et road movie) dans lequel un hors-la-loi est rejeté une seconde fois par une mère perdue de vue lorsqu'il n'avait que cinq ans. Tournant en quinze jours seulement, Kato, au lieu de découper ses plans, met à profit sa science du plan-séquence et la richesse de sa profondeur de champ pour un résultat remarquable qui arrive à conférer des « émotions aussi intenses avec de simples cris »(Shinji Aoyama).
Le second est l'ultime travail du maître : un documentaire, introuvable depuis trente ans, suivant une fameuse troupe de joueurs de taïko dont le nom donne son titre au métrage : Za ondekoza. Sortant bien souvent de son cadre pour proposer des séquences surréalistes, ce film posthume traverse les frontières du vrai et du faux et l'on trouvera une intéressante résonnance avec une autre dernière œuvre : celle du documentariste Shinsuke Ogawa. L'Histoire du village de Magino : le cadran solaire à unité de mille ans mélange lui aussi entretiens et mise en scène (grande première dans son travail), la célébration des valeurs telluriques assurant la connexion entre deux dispositifs dont l'embranchement pourrait paraître, à première vue, contre-nature. Le mélodrame aura une place de choix dans cette programmation : déjà honorés d'une rétrospective à la Cinémathèque française, Yasuzo Masumura et Kenji Misumi font leur retour avec deux inédits (La Vie d'une femme et 7). Faisant également découvrir de nouveaux noms, La Femme de là-bas est signé d'un réalisateur méconnu mais néanmoins passionnant : Hideo Suzuki (1916-2012). Portrait d'une femme forte dénué du moindre pathos, ce chef-d'œuvre des années 1960 trouverait peut-être son prolongement logique dans le genre roman porno dix ans plus tard. Angel Guts: Red Classroom, représentant véritablement le summum de l'expression du regretté Chusei Sone (1937-2014), propose également le portrait d'un personnage féminin en complète rupture affective, se conformant machinalement aux désirs des hommes.
Si Ishiro Honda, le papa de Godzilla, peut se vanter d'avoir été le cinéaste japonais ayant cumulé le plus de succès publics en France, le démentiel Matango n'a pourtant pas eu l'honneur d'une sortie sur notre territoire à l'époque. Ce sera donc l'occasion d'apprécier ce trip psychédelo-mycologique où d'infortunés naufragés découvrent, dans la moiteur d'une île perdue, la présence d'hommes-champignons aux motivations incertaines.
On peut citer encore l'extravagant Pistol Opera de Seijun Suzuki, mais cette brève énumération de titres ne témoignera jamais que d'une infime partie des découvertes à faire au cours de cette programmation. À l'heure où le public français aurait la fâcheuse tendance à juger principalement le cinéma japonais contemporain sur des critères plus sociologiques qu'esthétiques, il serait peut-être temps de revenir à ce qu'a longtemps été celui-ci pour l'observateur lointain : un cinéma de la pulsion, tour à tour érotique, cruel, et même expérimental, où chaque découverte réoriente notre imaginaire plutôt que de le conforter.
Clément Rauger