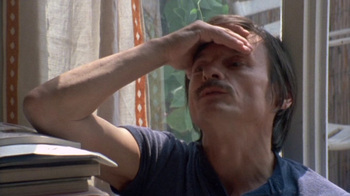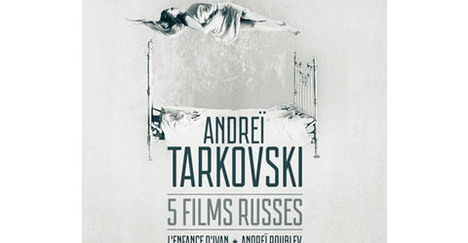Andreï Tarkovski
Du 28 juin au 12 juillet 2017
Sur le sentier de la mémoire
De L'Enfance d'Ivan à son dernier film, Le Sacrifice, Tarkovski aura filmé des visions et des ruminations, des rêves et des conversations, laissant aux premières le soin de déplier des formes picturales et énigmatiques quand les secondes se calaient sur les pas d'une déambulation, en cercles concentriques. Des dialogues filmés comme des marches, et des marches dessinées comme une exploration de la terre : mû par une intense quête spirituelle, Tarkovski ne visait ni le ciel, ni les ordres d'un outre-monde. Il fut, et demeura, même dans sa dernière période empreinte d'une forme plus traditionnelle de religiosité, un praticien du plan en plongée. Aussi, il ne faut voir aucune erreur d'aiguillage dans les études de géologie qu'il entama avant de se tourner vers le cinéma. Tarkovski était un homme de la terre, mouillée ou brûlée par le feu, démêlée par le vent, mais littéralement, indécrottable. Qu'on songe à cette scène de son film autobiographique, Le Miroir, où le personnage de l'enfant qu'il était traîne un peu de boue sur le plancher immaculé d'une datcha. Ses pieds sont nus, et cette nudité-là porte les traces de sa marche. Des années après, le réalisateur allait arpenter le cinéma comme ses personnages arpentent un espace de tourbe et de feuilles mortes, avec le souci de recueillir les mouvements du monde à travers une sensibilité dépouillée.
Andreï naquit dans la maison de campagne familiale, sur une table nue, un jour d'avril 1932. Son père, journaliste et traducteur, n'était pas encore le poète que l'Union soviétique allait célébrer plus tard. S'il quitta le foyer familial dès 1935, le dialogue ne cessera jamais, entre le père et le fils, entre la poésie de l'un et le cinéma de l'autre. Les vers d'Arseni Tarkovski se font ainsi entendre dans les films d'Andreï, comme un appel du fils au père, et un écho de ce qu'Andreï tente, par les moyens seuls du cinéma : présenter le flux de la vie sous une lumière neuve, débarrassée de son écoulement quotidien. Durée des plans-séquences, usage du ralenti, éclatement de la trame temporelle seront ainsi autant de recours aux possibilités plastiques du septième art pour mieux scruter l'épaisseur du temps. Le cinéma seul pouvait être son instrument.
Pour un cinéma sensitif
De retour à Moscou après une expédition comme géologue en Sibérie, il entra au VGIK, une des deux principales écoles de cinéma. Il y fit ses premières armes, signant trois courts métrages au temps de la période dite de « dégel » qui suivit le décès de Staline. Si son film de fin d'études, Le Rouleau compresseur et le violon, livre peu d'indices sur la révolution stylistique à venir, il montre déjà une prédisposition à filmer l'enfance, avec une assurance si convaincante qu'elle attira l'attention des autorités cinématographiques sur ce talent prometteur. En 1960, Le Goskino, véritable ministère du cinéma soviétique, lui confia ainsi les rênes d'un film sur un jeune orphelin servant d'éclaireur dans l'Armée rouge. De cet argument conventionnel, tiré d'une nouvelle de Vladimir Bogomolov, Tarkovski tire le singulier portrait d'un innocent et d'un monstre, capable de traverser les lignes ennemies en se mêlant aux eaux d'un fleuve filmé comme le Styx. Le jeune Ivan du titre annonce ainsi tous ses personnages d'enfants mutants, en communion avec les mystères de la nature, et dont le corps même est un lieu de miracles. Surtout, le cinéaste troue sa trame narrative de quatre séquences de rêve où éclatent ses audaces formelles. Auréolé en 1962 d'un Lion d'or au festival de Venise, Tarkovski fut dès lors assimilé à une nouvelle vague soviétique redécouvrant les éclats avant-gardistes du cinéma russe des années vingt. Mais on ne pouvait se tromper plus : si L'Enfance d'Ivan contient encore des cadrages expressionnistes et des points de montage signifiants, toute la filmographie ultérieure prolongera la quête, ici en gestation, d'un cinéma sensitif et rétif à toute clôture du sens. Et cette stylistique de la présence allait se manifester de façon saisissante dès son deuxième film, Andreï Roublev.
Cette ample fresque historique sur un peintre d'icônes au début du XVe siècle fut co-écrite avec son camarade Andreï Kontchalovski. Si le cinéaste y assume avec maestria certains passages obligés (la mise à sac de la ville de Vladimir, filmée comme un western épique), il transforme tout le projet en méditation intime sur la place de l'artiste dans un monde discordant. L'art, identifié à un absolu, s'y détermine comme l'unique religion possible, à la fois reprise de la Création et instrument de connaissance cathartique. Roublev est ainsi moins un homme de Dieu qu'un de ces intellectuels tourmentés qui peuplent l'univers du cinéaste, dans l'attente d'effectuer le saut vers la foi qui leur redonnera espoir. Le mysticisme de Tarkovski repose donc avant tout sur la présence matérielle des choses. Il filme la nature comme une manifestation silencieuse du monde : la pluie, si fréquemment associée à l'idée d'une Annonciation, est avant tout la réminiscence des pluies russes qu'il contemplait sereinement dans son enfance. Pour lui, le cinéma n'était pas un langage, et cette conception à l'opposée de celle d'Eisenstein, demeure centrale pour saisir ses films. Tarkovski récusait ainsi l'idée d'un cinéma de poésie, ce qui n'interdit pas de voir dans son œuvre une véritable poétique des éléments, à partir de laquelle se structureront désormais tous ses films.
Mysticisme
Mysticisme de la matière donc, mais mysticisme tout de même : de quoi embarrasser les autorités soviétiques qui ne surent jamais quoi faire de ce cinéaste. Andreï Roublev, achevé en 1966, ne fut visible dans son pays qu'en 1972. Jusqu'en 1982 et son départ pour l'Italie, Tarkovski fut un cinéaste empêché, multipliant des projets rejetés par le pouvoir soviétique. Quand enfin il tournait, ses films étaient délibérément mal exploités. En quinze ans, il ne put achever que trois longs métrages. Le premier, Solaris, fut conçu par les instances cinématographiques comme une réponse soviétique au 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Tarkovski détourna la commande pour en faire une introspection sur l'amour et le foyer, filmant la terre pendant toute la première heure de film, avant de réduire les motifs usuels de la science-fiction à une errance dans les ruines d'une station orbitale.
Le film plut, malgré tout, et permit au cinéaste de se lancer dans son projet le plus personnel, Le Miroir. C'est avec cette véritable épopée mémorielle que Tarkovski s'approcha au plus près de ce cinéma pur dont il rêvait. Chaque séquence y semble réagir à la précédente par un chemin secret, dont un son ou le détail d'une image constituerait un indice cartographique. En mêlant archives historiques et reconstitutions de souvenirs intimes, le cinéaste remonte jusqu'au lieu de sa conception, alors qu'il se filme alité et mourant, comme s'il répondait enfin au film de Kubrick sur un fœtus astral. La beauté expressive de ses séquences compose un écrin sensuel où le réalisateur, si puritain, se met en quête de la sexualité de sa mère, jouée, comme le personnage de son ex-femme, par une très sensuelle Margarita Terekhova. Chef-d'œuvre incantatoire et intime, mais film incompris, Le Miroir replongea Tarkovski dans le purgatoire du cinéma soviétique.
Il crut en sortir sept ans plus tard en revenant à la science-fiction avec son cinquième film, Stalker. Sur une musique électronique d'Eduard Artmeiev, le film liquide définitivement le décorum du genre pour ne plus filmer que la marche de trois personnages sur le chemin de la foi. C'est un virage discret pour Tarkovski : son mysticisme tend vers une croyance religieuse, hantée par l'Apocalypse, et qu'il n'abandonnera plus dans ses deux derniers films tournés à l'étranger.
En 1982, éreinté par des années de lutte avec les autorités soviétiques, il gagne l'Italie où il réalise Nostalghia, d'après un scenario de Tonino Guerra. Il filme l'exil, géographique et spirituel, comme une mélancolie terrassante. Mais la nostalgie du foyer n'est pas tout à fait celle qu'on croit : les maisons, dans Nostalghia ou Solaris, réapparaissent sous forme de reproductions, comme des artefacts imaginaires. Ce lieu de l'origine, si obsédant, n'a pas plus de consistance que le symptôme d'une maladie de l'âme. Nœud de toutes les projections mémorielles, il est aussi un décor vide que Tarkovski va brûler dans l'ultime plan qu'il tourne en Suède, pour son dernier film, Le Sacrifice. Peut-être lui faut-il la violence de ce geste pour continuer d'avancer. Mais voilà : le 26 mars 1986, affaibli par la maladie qu'on lui a détectée quelques mois auparavant à Paris, il écrit dans son journal : « J'ai plus de mal à marcher. » Il rêve de son père. La terre se dérobe sous ses pieds. Il s'éteint dans la nuit du 28 décembre 1986.
Guillaume Orignac