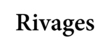Brian De Palma
Du 31 mai au 4 juillet 2018
Mécaniques fatales
Adolescent, découvrir les films de Brian De Palma, c'était rencontrer le cinéma lui-même. Lorsque Carrie embrasait le bal de l'école, il n'y avait pas seulement une image sur l'écran mais deux et même trois. Dans Pulsions, pendant dix minutes muettes, la caméra en apesanteur suivait Angie Dickinson dans les allées d'un musée, en une sidérante anamorphose de la mort et du désir. Dans Furie, la colère d'une adolescente au regard turquoise faisait exploser un père maléfique. Découvrir le cinéma de Brian De Palma, c'était comme une naissance violente, sanglante et érotique à la cinéphilie.
Démonter « Vertigo »
De Palma fut notre meilleur professeur de cinéma, celui qui nous montra le chemin vers Hitchcock, Welles et Michael Powell, mais qui nous dota en retour d'une adolescence gothique. Lorsque dans Blow Out John Travolta plaçait le cri d'agonie de la fille qu'il aimait sur les images d'un film d'horreur de série Z, c'était comme s'il nous délivrait un secret : tout nous ramènera fatalement à la chambre noire, entre nécromancie et science des rêves, où l'on converse avec les morts. Né en 1940, Brian De Palma fut lui-même ce garçon solitaire et obscur, capable de construire un ordinateur et de remporter un concours. Sa carrière scientifique fut dévastée par un film : Vertigo. « Un univers complètement fermé. Il capturait vos émotions et votre esprit. Incroyable. J'étais quelqu'un de très pragmatique. Je regardais et je me disais : "OK, comment on fait ça ?" Quand j'étais gamin, je regardais une machine et je me disais : "Voyons comment ça marche". » (Susan Dworkin, Double De Palma). Ainsi, on pourrait démonter Psychose ou Vertigo, mettre à plat leurs mécanismes et puis les remonter ? Dans les hypnotisantes séquences au ralenti où des éléments dispersés finissent par se nouer, ses films ont bien sûr des allures d'horlogeries parfaites. Mais ces grandes séquences lyriques peuvent aussi se réduire à de petits automates cruels. C'est par exemple la porte de l'ascenseur qui bute contre le bras du cadavre de Kate Miller dans Pulsions et lui imprime une atroce vie artificielle. C'est encore la spirale de Vertigo qu'on retrouve au bout de la perceuse qui transperce Gloria Revelle dans Body Double. Pourtant, ce qui empêchera toujours De Palma d'être un froid créateur de dispositif tient à la nature profondément élégiaque de son cinéma. Aucun cinéaste n'accorde au moment de leur mort de tels regards à ses personnages. Ils ne crient pas : ils pleurent devant les rasoirs tendus, les perceuses ou les couteaux. Quant aux survivants, ils restent toujours sidérés, hantés et se réveillent en tremblant de cauchemars qui s'emboîtent à l'infini. Cet « univers complètement fermé » qui avait tant fasciné De Palma dans Vertigo est celui de la tragédie et des oracles. À la fin de Blow Out, Jack court à perdre haleine pour sauver la fille qu'il aime mais il est comme englué dans un temps où tout est perdu d'avance. Sur le brancard qui l'emmène aux urgences, Carlito dans L'Impasse revoit les derniers mois de sa vie mais peut-être les ré-imagine-t-il et essaye-t-il d'en changer le cours. Fatalement, comme l'homme croisant sa mort à Samarcande, il se retrouve à l'endroit exact où le mauvais sort doit s'accomplir.
La chambre noire
Au cours d'une carrière qui épousa parfois celle de ses compagnons de route – Scorsese, Coppola ou Spielberg –, il a connu le succès avec des épopées mafieuses (Scarface, Les Incorruptibles), joué les artificiers pour Tom Cruise (Mission : Impossible), adapté des best-sellers (Le Bûcher des vanités) ou abordé les « grands sujets » américains comme le Vietnam (Outrages). Mais même à l'intérieur d'un grand film de studio, la vérité de son cinéma est toujours la chambre noire où se referme Blow Out. Dans Mission : Impossible, juste avant qu'il ne lance les grandes orgues lors de la scène de l'Eurostar, la résolution de l'intrigue a lieu dans un wagon aussi sombre et poussiéreux que la cave de Psychose, où un fils arrogant et manipulateur emprunte le visage de son père pour faire avouer leurs fautes à ses parents. De Palma revient toujours dans cette fabrique des images, pour inventer un cinéma qui soit d'abord une « dream machine ». Dans cette chambre, le temps est malléable à merci, comme dans Femme fatale, où l'héroïne rêve sept ans de sa vie pendant les quelques secondes où elle s'endort dans son bain. C'est le lieu où s'élaborent les idées les plus folles, comme la revenante de Passion qui assiste narquoise à son propre enterrement. C'est là également que sont forgées certaines images, fragiles et troublantes, comme dans L'Esprit de Caïn ce plan unique vu à travers les yeux d'une enfant tombant d'un balcon : une constellation d'oranges au-dessus de la pointe d'un cadran solaire. On a l'impression de découvrir les motifs qui hanteront la fillette, comme les souvenirs parcellaires de Marnie (Hitchcock). Les portes de ce monde de fantômes se referment sur elle, avec pour gardiens les doubles de son père.
La fleur du mal
Tout Body Double était la relecture terrifiante de Vertigo et Fenêtre sur cour à travers les images à consommation rapide des années 80 : le clip, le porno et l'horreur de série Z. Dans Passion, il s'emparait de l'esthétique de notre époque, tout aussi vulgaire mais bien moins dionysiaque. Internet, téléphones portables et postes de surveillance : les caméras sont partout, le voyeurisme généralisé et la cruauté ordinaire. Dans le funèbre Dahlia noir, où il revient sur l'assassinat d'Elizabeth Short en 1946, il remonte la généalogie du mal. Les assassins ne sont que deux pauvres fous mais la vraie figure maléfique est l'homme qui s'est enrichi en créant Hollywoodland avec Mack Sennett, pour ensuite recycler le bois pourri des studios dans les quartiers pauvres de la ville, et construire des bâtisses prêtes à s'enflammer comme de la vieille pellicule. Telle une gangrène qui s'étend et infecte le monde et les rêves, le mal vient de cette préhistoire de Hollywood qui est aussi celle du capitalisme. Alors que Hollywood entre dans son âge d'or, on tourne des films pornos dans les décors abandonnés de L'Homme qui rit de Paul Leni et on y assassine des starlettes. Dans les bouts d'essais que se repasse sans fin le détective, une voix dirige Elizabeth, et tente de lui faire jouer l'émotion. Cette voix pleine de lassitude appartient à Brian De Palma, et s'il donne à Elizabeth un visage, ces quelques mètres de pellicule noir et blanc sont aussi l'autoportrait mélancolique du cinéaste à jamais captif, lui aussi, des images défuntes.
Stéphane du Mesnildot