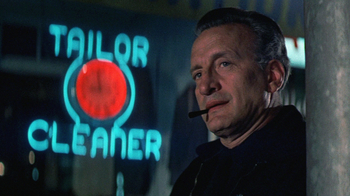Good Cop, Bad Cop
Du 5 au 30 juillet 2017
Sur trente ans, les feuilletons et séries télé américaines ont galvaudé jusqu'à la corde le thème du policier et ses problèmes personnels : avec son travail, avec les autorités, avec sa famille (ou absence de), mais aussi des flics de plus en plus affectés par les guerres de services. Entre 1968 et 1980 (presque tous semblent être sortis en 1973), les films américains offrent plus qu'un genre renouvelé : un portrait réaliste et inquiétant du pays en pleine révolution culturelle et guerre de générations. La torpeur satisfaite des années Eisenhower est terminée. Les flics vont nu-tête, la pilosité n'est pas réservée aux hippies mais pousse sous les casquettes ; on n'a jamais vu une telle floraison de moustaches, tignasses, boucs et rouflaquettes. Ces films offrent aussi un portrait sans fard des grandes métropoles américaines, New York, San Francisco et Los Angeles, quand elles étaient sales, uniques, vibrantes et pas encore aseptisées par la mondialisation.
C'est l'époque où Hollywood ne filme plus dans son jardin, et ne sert plus de vitrine à la police de Los Angeles, jusqu'alors sous la poigne militaire de son chef William Parker, qui utilisait le cinéma et la télévision (Dragnet, Perry Mason) comme instrument de relations publiques. Joseph Wambaugh, qui fut l'un de ses inspecteurs pendant dix-sept ans, résume parfaitement le changement : « Avant, avec le police procedural, on voyait comment le policier affectait l'enquête. Maintenant, on voit comment l'enquête, le travail, affectent le policier. » Un bon tiers des films de ce programme ont fait l'objet de manifestations et boycotts à leur sortie : homosexuels, Portoricains, féministes, Blacks (on ne les appelait plus Negroes, et pas encore African-americans), travestis, groupuscules révolutionnaires..., il n'est pas une minorité qui ne se soit sentie insultée. De qualité inégale, ces films ne parlent pas encore la langue de bois du politiquement correct. Choqué de voir le film qu'il avait écrit pour Howard W. Koch, Badge 373, harcelé par les protestataires, Peter Hamil se défendait dans une de ses chroniques du New York Post : « Je n'ai pas écrit un film raciste, mais juste décrit un flic raciste, tel que j'en connais des douzaines à Manhattan. » Ce sont les mêmes œillères qui ont en France, par exemple, longtemps relégué Clint Eastwood dans le camp des dinosaures facho-machos – avant la canonisation que l'on sait.
L'ADN du genre
Mais c'est aussi la décennie où tout le monde, et pas seulement les hippies, appelait couramment les flics des « pigs ». À partir de 1973, les flics voudront aussi « être compris ». Aucun homme n'a autant creusé ce sillon que le romancier Joseph Wambaugh. Il travaillait encore pour le LAPD quand il a écrit Les Nouveaux centurions et The Blue Knights, l'un filmé avec George C. Scott, l'autre pour la télé avec William Holden et Lee Remick. Il y était encore quand il a commencé à concevoir le feuilleton Police Story pour David Gerber et NBC, qui rompait avec les poncifs du genre. D'abord, il sondait la mémoire de véritables policiers. Il employait aussi une variété inédite de vedettes du passé : rien que pour le pilote de la première saison, Vic Morrow, Ed Asner, Ralph Meeker, Chuck Connors, mais aussi Harry Guardino en officier raciste – le même Guardino qui servait de partenaire à Madigan dans le film éponyme de Don Siegel (1968) et à « Dirty » Harry Callahan-L'Inspecteur Harry (1971), le film qui constitue avec Bullitt l'ADN de ce qu'on appelle en Amérique les rogue cop movies, les films de flics rebelles ou véreux, ceux qui nous occupent ici.
Le Détective (Gordon Douglas, 1968) ou Police sur la ville (Don Siegel, 1968) étaient encore des panoramiques, avec des scénarios symphoniques dont l'ambition était de faire état de la corruption à tous les niveaux qui peut grever une métropole. Le premier film policier à casser le moule a été Bullitt en 1968, qui se concentrait sur la rivalité entre un ambitieux politicien (Robert Vaughn) et un flic taiseux et obstiné, joué par Steve McQueen. Les deux choses inédites qui distinguaient ce film – l'usage fait de San Francisco, la poursuite toboggan entre la Dodge Charger de Bill Hickman et la Mustang GT Fastback de McQueen n'étaient qu'en partie dues aux scénaristes, au metteur en scène Peter Yates et au producteur Philip D'Antoni.
Comme me l'a récemment dit ce dernier, qui continuera la recette avec The French Connection et son propre The Seven-Ups : « Le film que j'envisageais était tout différent. Mais j'avais un deal chez Warner, et la compagnie de McQueen était intéressée par ce que j'avais développé à partir d'un polar de Robert L. Fish, intitulé Mute Witness. Pour vous donner une idée, le flic était prêt à partir en retraite, et je voulais engager Spencer Tracy ! » Mais quand on prend McQueen, on travaille pour McQueen. Il a mis son scénariste dessus (Alan Trustman), et le film est devenu ce qu'il est devenu. D'Antoni par contre est celui qui a insisté pour avoir une poursuite de voitures ; trois ans plus tard, il marquera l'histoire du cinéma en lâchant William Friedkin dans les rues de New York et en faisant doubler Gene Hackman au volant par le même cascadeur, Bill Hickman.
De plus en plus noir
En cinq ans, le genre a perfusé nombre de films en autant de concoctions aussi corrosives qu'explosives, tant dans la forme que dans le contenu : de la comédie (Les Anges gardiens, Richard Rush) au drame réaliste en passant par la satire. Le premier épisode de Police Story, la série créée par Joseph Wambaugh, recycle sans tiquer une réplique que Frank Bullitt disait au politicien : « Bossez de votre côté de la rue, je bosserai du mien. » Sauf qu'avec Wambaugh, c'est devenu un flic véreux reconverti en indic qui parle à un capitaine des Mœurs. La guerre des services a commencé.
Mais les cinq ans se sentent de façon plus frappante encore si l'on compare Bullitt et Le Flic ricanant, tourné en 1973 dans un tout autre San Francisco par le toujours intéressant Stuart Rosenberg. À la narration conventionnelle du film de Yates se substituent les méandres d'une intrigue archi-compliquée. Quand McQueen rentre chez lui, c'est pour retrouver une fille sexy et intelligente (Jacqueline Bisset) dans son lit ; il habite un San Francisco aussi étincelant qu'ensoleillé. Walter Matthau, lui, vit dans la cité dortoir de Daly City. Sa femme « se laisse aller », ses deux enfants l'ignorent. Le film de Rosenberg est tourné en hiver dans des rues poisseuses et luisantes. Robert Altman est aussi passé par là : les dialogues se superposent, limite audibles, et Matthau a autant de pistes à suivre qu'il y a de victimes dans le massacre de l'autobus. On a peine à croire que le scénario soit basé sur un roman suédois (Per Wahlöö et Maj Sjövall). Matthau découvre que son partenaire (une des victimes) prenait des photos pornos avec sa femme. Il envoie l'irritant Bruce Dern, son nouveau partenaire, faire l'espion dans un leather bar homo, où des Go-go boys dansent sur scène. C'est le nouveau San Francisco, celui que voudra nettoyer Dirty Harry.
Il faut aussi parler de hiérarchie. Même si les polars les plus connus de la période figurent ici comme pierres de touche de cette programmation, d'autres plus obscurs sont souvent d'une originalité et d'une complexité plus payantes. L'étonnant Report to the Commissioner, par exemple, a été réalisé par un prof de cours dramatique de Beverly Hills (il est mort en février dernier) ; le nom de Milton Katselas en dit sûrement moins aux cinéphiles que celui de Sidney Lumet. Pourtant son film supporte avantageusement la comparaison avec Serpico et paraît dix fois plus dur sur les thèmes du racisme et des dommageables guerres de services. Ici l'acteur noir Yaphet Kotto (aussi présent dans cette programmation que Roy Scheider) est inoubliable, jouant une sorte d'Oncle Tom à l'envers, ayant dû toute sa carrière se montrer doublement dur avec les siens pour s'imposer parmi ses collègues flics (dont le répugnant Hector Elizondo, futur pilier de Hill Street Blues). La jeune recrue qu'on lui impose comme partenaire, joué par le lunaire et proto-hippie Michael Moriarty, est encore une nouvelle donnée du genre : « Maintenant que le problème c'est les jeunes, explique Kotto, j'hérite d'un type comme toi ». Report to the Commissioner est plus cynique et pessimiste, si possible, que Serpico. Le rapport, qui incrimine tout le monde, sera remisé dans un tiroir. Le film est plus dur sur le racisme aussi : même les flics « larges d'esprit » ne peuvent supporter l'idée d'une jeune policière infiltrée (la rayonnante Susan Blakely) vivant avec un séduisant dealer nommé Stick. Et comme la production ne pouvait se payer la rituelle poursuite de bagnoles, on a une mémorable filature des suspects par un cul-de-jatte sur roulettes (inoubliable Bob Balaban).
Avec des vrais flics dedans
Tout au long de cette série de films, le rôle de certains vrais policiers a été déterminant. Wambaugh par exemple, avait fait une liste des policiers du LAPD qu'il trouvait de bons raconteurs d'histoire. Sur Police Story, les différents scénaristes travaillaient avec ces policiers. L'avantage était double : ils fournissaient les anecdotes, garantissant du même coup le réalisme des dialogues et des comportements. Mais Hollywood coupait dans les deux sens : Wambaugh fut ainsi à ce point choqué de l'adaptation par Robert Aldrich de son roman « choral », The Choirboys, qu'il a fini par vouloir contrôler les productions lui-même. « Bonne façon de perdre son argent », m'avait-il dit en 1980 quand je l'avais interviewé pour la radio dans sa maison de South Pasadena. C'était après la sortie de The Onion Field, basé sur un double meurtre qui avait bouleversé le LAPD dans les années 60. James Woods y jouait un malfrat à la petite semaine, mythomane et très tordu, et en faisait un personnage à la Jim Thompson.
Les deux autres pierres de touche de cette série sont les flics new-yorkais Sonny Grosso et Eddie « Popeye » Egan, inspirant le tandem joué par Roy Scheider et Gene Hackman dans le film de Friedkin. Grosso deviendra producteur de séries télé. Egan, le plus controversé des deux, aura son heure dans le show business (acteur dans Baretta, Police Woman, etc.), mais aussi ses déboires professionnels : il a été renvoyé du NYPD juste avant la retraite et a dû poursuivre le service en justice pour être réintégré. Pour la petite histoire, le « Badge 373 » du film de Howard Koch était le sien au NYPD ; il y joue le supérieur d'« Eddie Ryan », le policier raciste et solitaire incarné par Robert Duvall. L'affiche clamait : « Un feu dans sa chaussette, un démonte-pneu à la ceinture, et pas d'insigne. C'est l'histoire d'Eddie, le meilleur ex-flic dans le métier. » À côté d'Eddie Ryan, Dirty Harry est un modèle d'œcuménisme racial. Et il faut le voir abandonner sur l'asphalte sa copine qui vient de se prendre une balle dans la tête à sa place, pour courir après son agresseur... L'ennemi juré de Duvall est Cubain, mais un « méchant » d'une autre espèce : joué par le suave Henry Darrow, « Sweet William » trempe dans toutes les affaires louches de la ville ; c'est aussi un intello amateur d'art qui cite Ionesco et Ortega y Gasset. Sa mort sur une grue, une sorte de « Top of the world, Ma! » du pauvre, est pour les annales.
The Seven Ups, en 1973, donnera à Philip D'Antoni l'occasion de surpasser à la fois la poursuite de voitures de Bullitt et celle de French Connection. Producteur de ces deux derniers films, il en a tous les ingrédients : Roy Scheider, Tony Lo Bianco, et Bill Hickman pour les cascades. Et s'il remplit amplement le contrat pour la poursuite, on peut s'instruire en comparant, avec le sien, l'usage que fait Friedkin des deux acteurs de D'Antoni dans French Connection. Une note enfin sur l'inclusion de Fort Apache, the Bronx : bien que le film soit sorti en 1981, le scénario de Heywood Gould était écrit en 1973 ; les attitudes et désillusions sont aussi celles des années 70.
Philippe Garnier [qui remercie Nicolas Saada, avec qui il a conçu cette programmation lors d'un strip-poker cinéphilique.]