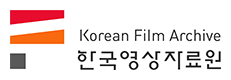Im Kwon-taek
Du 2 décembre 2015 au 29 février 2016
La Corée, corps et âme
Être l’auteur de plus de cent films est une particularité dont peu de cinéastes encore en activité peuvent s’enorgueillir. Une telle prolixité fut sans doute caractéristique de systèmes de production déterminés par la fabrication « à la chaîne » de films bon marché, pour un public consommateur à outrance de mythologies sur celluloïd. Auteur d’une filmographie dont la dimension le rapprocherait du plus prolifique des faiseurs de séries B hollywoodiens, Im Kwon-taek pourrait condenser, à lui seul, les qualités d’un cinéma national qui va éclore dès la fin des années cinquante. Pur produit d’une industrie au service du divertissement populaire tout autant que de la propagande, et auteur d’une œuvre non seulement personnelle, mais reflet pensif du monde qui l’a engendrée, Im Kwon-taek est né le 2 mai 1936 à Changsong.
Après une enfance et une jeunesse difficiles, marquées par la guerre et ses séquelles, il devient l’assistant du réalisateur Chung Chang-hwa, avant de passer lui-même à la réalisation en 1962. Jusqu’à la fin des années 1970, Im Kwon-taek va enchaîner les films à un rythme frénétique, accumulant à une cadence infernale les productions de genre à petit budget. L’industrie cinématographique coréenne est alors déterminée par un système protectionniste, qui soumet l’importation de films étrangers à la fabrication et à la distribution de productions locales. C’est l’époque des films à petit budget, tournés à l’économie et destinées à un public populaire friand de cinéma. Im Kwon-taek participe de cette frénésie en enchaînant westerns mandchous (1969 : Eagle of the Plain, 1970 : Park, le borgne, 1973 : The Big Chase), drames d’époques (1963 : Une épouse changée en pierre), films de sabre (1969 : La Nuit de la pleine lune, 1970 : L’Epée sous la lune), mélos féminins (1971 : La Seconde mère), films de gangsters (1971 : La Spirale des trahisons à Myeondong), bandes guerrières et anti-rouges (1973 : La Bataille du 38e parallèle, 1976 : Et coule la rivière Nakdong). Le début de sa carrière aura consisté en une immersion dans ce qui aura fait le cinéma coréen populaire avant qu’une nouvelle génération de cinéastes, souvent formée par l’activisme contre le régime autoritaire, n’en régénère la production.
Cette première partie de carrière, Im Kwon-taek a longtemps refusé de la montrer, après que les transformations du système cinématographique et politique sud-coréen eurent déterminé enfin la possibilité pour le réalisateur de signer des œuvres personnelles, détachées des prescriptions des genres et de la fabrication en masse de programmes pour les salles. C’est ainsi qu’Im Kwon-taek peut tout autant incarner la vitalité d’une cinématographie qui se renouvelle au milieu des années 1990 qu’une certaine tradition qu’il nous est désormais donnée de découvrir. Car la rétrospective que nous lui consacrons montrera enfin une grande partie des œuvres réalisées avant la découverte (tardive en France) de ses films plus personnels. Histoire d’observer comment le cinéaste a pu réussir parfois à subvertir les conventions, à dépasser les clichés par des choix de mise en scène particuliers, une attention portée à des personnages qui parvenaient à transcender leur nature de stéréotypes et de fictions propagandistes (La Bataille du 38e parallèle), à inventer des dramaturgies singulières.
Celui qui construisit une œuvre qui aura été, dans ses débuts, le pur produit d’un système taylorisé et stakhanoviste, aura, et ceci n’est sans doute pas étranger à cela, su capter la nature profonde de la Corée, saisie dans son passé et son présent. Ce qui se situe au cœur de l’œuvre d’Im Kwon-taek est sans doute ce rapport complexe entre l’Histoire concrète et sa représentation imaginaire, entre corps et âme nationale, pourrait-on dire. Si La Fille du feu (1983) évoque la puissance obstinée du chamanisme, Mandala (1981) et Viens, viens plus haut (1989) traitent du poids du bouddhisme dans la pensée coréenne. Le féodalisme est ce qui détermine des récits comme celui de La Chronique du roi Yonsan (1987), La Mère porteuse (1986) ou Le Chant de la fidèle Chunhyang (2000). Enfin, les déchirures tragiques du XXe siècle sont le cœur de Gilsodom (1985), incroyable récit de retrouvailles (de très nombreuses familles furent séparées par la guerre), où les liens du sang vont se heurter à la brutalité des barrières de classe, tout comme La Poursuite de la mort (récit de vengeance impossible d’un policier contre le partisan communiste responsable de sa déchéance).
Mais ce qu’aura exemplairement su capter le cinéma d’Im Kwon-taek est sans doute une forme d’énergie particulière, une tension, souvent sexuelle, qui innerve tout autant une chronique rurale comme Le Village des brumes (les femmes d’une bourgade utilisent un simple d’esprit comme jouet sexuel), qu’un drame féodal comme La Mère porteuse (un jeune prince éprouve une irrépressible passion charnelle pour la jeune fille désignée pour subroger à son épouse stérile). Son plus grand succès en France, Ivre de femmes et de peinture (2002) fond l’Histoire et le désir comme la matière même du génie artistique.
On peut être frappé par des procédés de mise en scène employés, délibérément obsolètes parfois (l’usage du zoom qui contribue à l’étrange beauté de certains titres), par cette volonté de refuser de se couler dans un style résolument « moderne » mais bien plutôt de saisir l’évidence fascinante et violente de l’Histoire et de la société coréennes et des pulsions qui les traversent.
Rien n’aura sans doute autant défini l’art d’Im Kwon-taek que le pansori, cet art vocal, narratif et musical, qui est au centre de plusieurs titres du cinéaste comme La Chanteuse de pansori, qui relate l’histoire mélodramatique d’une chanteuse maltraitée par son père, ainsi que sa « suite » en 2007 (Souvenir), et surtout Le Chant de la fidèle Chunhyang, représentation à la fois de la performance sur scène de la chanteuse et reconstitution cinématographique du récit conté par elle. Découvrir le cinéma d’Im Kwon-taek dans sa pleine et monumentale dimension, c’est se trouver au croisement impossible d’un anti-brechtisme cathartique et d’une volonté quasi scientifique de passage en revue de ce qui fait l’exception coréenne.
Jean-François Rauger