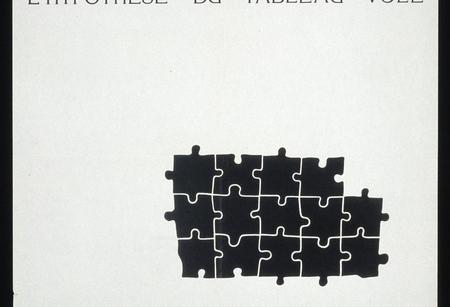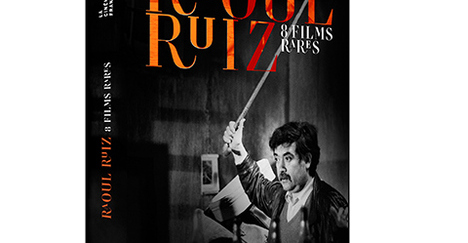Raoul Ruiz
Du 30 mars au 30 mai 2016
Vertiges et enchantements
Deux films réalisés entre la France et le Portugal, au début des années 1980, permettent de pénétrer au cœur du cinéma de Raoul Ruiz, au moment où celui-ci prend forme sous ses traits les plus singuliers. Dans Les Trois couronnes du matelot (1982), un marin en escale dans un port de la Baltique raconte son histoire à un étudiant rencontré la nuit sur les quais. Celui-ci devra l'écouter jusqu'au matin, avant de prendre sa place à bord du navire, parmi un équipage dont il sera le seul vivant, et perpétuer ainsi une « histoire immortelle » – un récit prédateur qui l'élit comme victime pour pouvoir advenir une fois de plus. De tels récits, ou plus souvent leurs lambeaux épars, sont la chair de ce cinéma, son « réel ». Pour leur donner forme, Les Trois couronnes du matelot déploie un baroque multi-dimensionnel qui deviendra le signe de Ruiz : baroque d'une narration qui se démultiplie, se diffracte et conduit, de glissement en glissement, à un espace insituable du récit ; baroque visuel, par lequel les effets, l'artifice revendiqué, précipitent chaque plan dans la dimension du simulacre total.
L'envoûtante dérive somnambulique qu'est La Ville des pirates (1983) réunit dans un rapport incertain, mais sous le sceau d'une splendeur à couper le souffle, une côte battue par les vagues, un enfant assassin à l'innocence enjôleuse (Melvil Poupaud), une servante hallucinée et une île des pirates révélée dans la flaque de sang d'un crime. La chaîne distendue des causalités met le spectateur dans un état de flottement, que les actes sanglants zébrant l'avancée du film parviennent à peine à déranger. Logique du rêve, aberrations, sursauts qui désignent la veine surréaliste de l'œuvre.
Raoul Ruiz est né en 1941 à Puerto Montt, dans le Sud du Chili. Sa découverte, enfant, du cinéma tiendrait dans une rêverie : dans Ben-Hur, un avion passe au loin. Plus tard, le même traverse le ciel de Cléopâtre. Le DC-6 éternel devient le chiffre secret du péplum. Ce qu'il traduira plus tard : le sens dernier des images échappe toujours au contrôle de l'industrie qui les crée.
À 15 ans, il se met au défi d'écrire cent pièces de théâtre, ce qu'il fait en six ans. L'anecdote est prémonitoire des 120 films à venir. Au même moment, il étudie le droit et la théologie. En 1968, il réalise Tres tristes tigres, son premier long métrage, qui remporte un Léopard d'or à Locarno. Symbole d'un nouveau cinéma chilien, le film excède son postulat réaliste par des décentrements constants et une bizarrerie diffuse, allant jusqu'à donner l'impression parfois de s'absenter de lui-même. Rien n'annonce encore le cinéma illusionniste à venir, mais les films qui suivent (Nadie dijo nada, La Colonia penal) creusent le sillon des situations paradoxales. Un inimitable ton de farce distanciée y est déjà à l'œuvre.
Engagé politiquement aux côtés de Salvador Allende, Ruiz est contraint à l'exil par le coup d'État de septembre 1973. En février, il arrive à Paris. En mars, il tourne Dialogue d'exilés, sorte de film d'intervention qui déroute par son extravagance et son ironie. La suite sera une mue et une accélération. À cette époque, l'INA produit sans beaucoup de contraintes un quota annuel de films destinés à la télévision. Le champ est libre pour tout expérimenter. Ruiz y est plus qu'à son aise et tout son cinéma paraît s'y matérialiser immédiatement. Deux grands directeurs de la photographie (Sacha Vierny et Henri Alekan) échafaudent avec lui les trucages de ses pièges baroques : filtres, fumées, miroirs, déformations, et la double profondeur de champ (split field) qui l'obsèdera longtemps. En découvrant La Vocation suspendue (1977), le premier film de Ruiz pour l'INA, Manette Bertin, la directrice de l'institution, s'exclame : « Mais c'est formidable ! Personne n'y comprendra rien. »
Ce que l'on ne tardera pas à comprendre, en revanche, c'est que l'œuvre de Raoul Ruiz, dans sa prolifération, arase hiérarchies et classifications, et prend l'allure d'un long continuum où chaque objet, fait de reprises, imitations secrètes, recyclages, cultive son imperfection poétique, et où les mêmes obsessions reviennent sans cesse, dans toutes les combinaisons possibles. La période INA se prolongera quelque temps, mais Ruiz l'ubiquitaire est déjà souvent ailleurs. Au Portugal, il filme Le Territoire (1981), récit d'une excursion glissant dans le cannibalisme. En Hollande, la Patagonie rêvée du Toit de la baleine (Het Dak van de Walvis, 1982), fable ethnographique où langues et identités se brouillent jusqu'à s'anéantir au contact du monde indigène. À Madère, Les Destins de Manoel (1985), conte fantastique en état d'enfance, l'un de ses plus beaux films.
Un film qu'il réalisa au Honduras en 1975 s'intitulait Le Corps dispersé et le monde à l'envers. De corps dispersés, il est quelquefois question dans son cinéma (Colloque de chiens, 1977, chef-d'œuvre de récit circulaire borgésien), mais plus souvent encore la matière humaine y est mutilée, dégradée, parasitée, mangée, dans une indifférence insistante : démonstration, sans doute, que le cinéma est affaire de fantômes (qui peuvent bien se le permettre) pris dans la chair de l'image. Et qu'un film peut devenir pour les vivants une allégorie en boucle de la réalité – comme il le sera pour le projectionniste candide de La Chouette aveugle (1987) et les adorateurs du Film à venir (1997).
À partir de Trois vies et une seule mort (1996), son cinéma se transforme. Moins énigmatique, plus littéral, plus « français » en un sens. On y trouve une relecture de tout ce qui précède en même temps qu'une exploration joueuse des virtualités de la narration : scintillements de la mémoire du Temps retrouvé (1999), vertiges combinatoires de Combat d'amour en songe (2000), méandres feuilletonnesques de Mystères de Lisbonne (2010). Vient aussi le temps, des années 2000 jusqu'à sa mort en 2011, d'un retour au Chili sous les noms d'un pays de mythe, « Cofralandes » ou « Recta provincia », un Chili de l'enfance, peuplé désormais de vieillards à la mémoire interminable.
Dans sa Poétique du cinéma, essai de théorie et fenêtre ouverte sur son érudition tentaculaire et joyeuse, Raoul Ruiz met en garde contre la tentation d'un cinéma d'« images utopiques », images de nulle part, univoques, vouées à la communication. Lui en appelle aux miroitements de la polysémie et aux mirages qui s'entredévorent. « Bon courage à celui qui veut être ruizien », prévient Melvil Poupaud. On aimerait quand même essayer.
Nicolas Le Thierry d'Ennequin